Écrire et traduire pour inclure
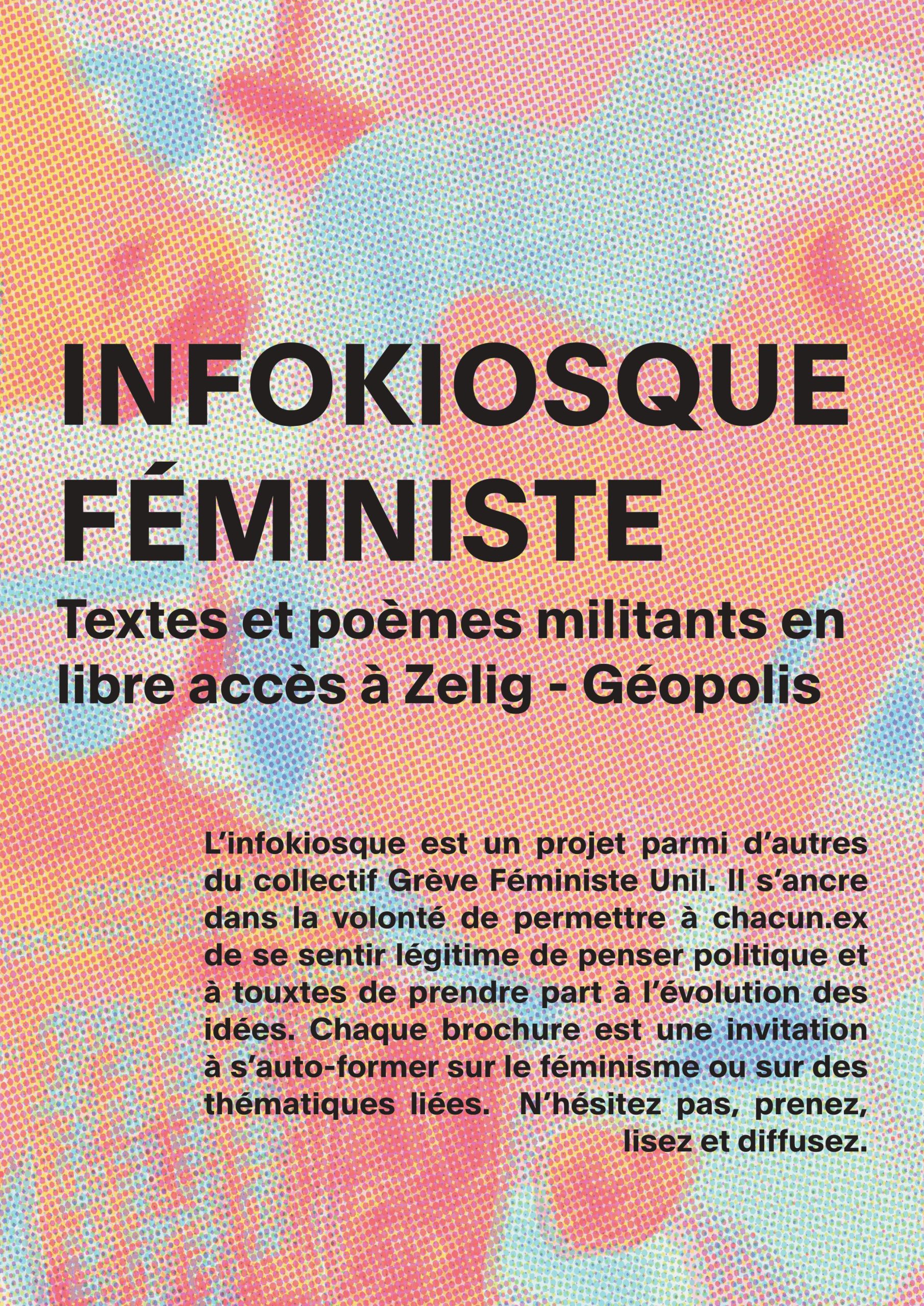
@ Collectif Grève Féministe Unil
INTERVIEW · Travail de recherche sur la place de l’écriture dégenrée dans le monde éditorial, en collaboration avec le Collectif de la grève féministe de l’UNIL et Roxane Bovet, éditrice de la maison d’édition genevoise Clinamen.
Dans le cadre du programme de spécialisation en traduction littéraire de l’UNIL, j’ai décidé d’effectuer mon projet personnel d’études traductologiques sur l’écriture dite «inclusive» ou dégenrée. Je suis partie du constat que pour traduire de l’anglais, langue avec un genre grammatical relativement neutre, au français, langue marquée structurellement et historiquement par le genre, il fallait prendre la décision, ou pas, de traduire en français inclusif. Le français inclusif reste, pour le moment, un projet relativement niche et se développe principalement dans les milieux militants, qui deviennent des laboratoires linguistiques et expérimentent avec la langue française. Il commence à s’implanter petit à petit dans le monde éditorial, sous forme de re-féminisation du langage, mais reste une exception. Quant au langage neutre, sans binarité de genre, il n’évolue, pour le moment, qu’au sein des sphères militantes. Pour alimenter ce travail de recherche, je me suis penchée sur mes travaux effectués avec le Collectif de la Grève Féministe de l’Université de Lausanne. Ce collectif, qui existe depuis 2018, a pour but de promouvoir l’égalité et la lutte contre les discriminations systémiques au sein de l’UNIL. Les membres·x du collectif s’occupent, entre autres, de sélectionner différents zines, de les imprimer et de les distribuer dans les infokiosques des bars associatifs de l’UNIL (Zelig) et de l’EPFL (Satellite) ainsi que dans la cafétéria associative et autogérée du bâtiment Anthropole (NoCAP). Avec le collectif, nous avons sélectionné des zines qui traitent de problématiques féministes et transidentitaires, rédigés en anglais, pour les traduire en français afin qu’ils soient davantage accessibles à tous·tes·x. Mais alors, qu’est-ce qu’un zine? C’est un petit fascicule autoédité et autodistribué. Toute personne peut rédiger un zine, ce qui offre une grande liberté créatrice. Ces livrets se concentrent généralement sur des problématiques liées aux populations marginalisées et sur des thématiques engagées. L’inclusivité, au niveau des thèmes abordés et de la langue, est donc de mise.
Pour m’informer de la traduction du langage inclusif de l’anglais vers le français, je me suis entretenue avec Roxane Bovet, co-fondatrice de la maison d’édition genevoise Clinamen. La maison d’édition a vu le jour en 2014 et valorise une littérature dont les positionnements sont particulièrement «ambigus, expérimentaux et difficilement définissables». Toutes leurs publications sont rédigées en écriture inclusive.
Peux-tu te présenter en quelques mots?
Roxane Bovet, curatrice (Rita Residenza) et éditrice (Éditions Clinamen). Clinamen est spécialisée dans l’édition d’art et de pensée critique, nous menons actuellement un projet de traduction collective d’une anthologie anarchiste qui a pour objectif de faire de la traduction un espace social.
Quelle est la place du langage inclusif dans le monde de l’édition?
Le monde de l’édition est si vaste qu’il me semble impossible de répondre de manière homogène. Tandis que certaines structures ne se posent même pas encore la question, pour d’autres le langage inclusif est au centre de toute la pratique éditoriale. Les éditions du Commun, à Rennes, par exemple, ou Hystériques & AssociéEs en Belgique, militent pour un renversement des codes normatifs avec une attention au langage comme outil de transformation sociale.
Préfères-tu utiliser toutes les options inclusives (point médian, épicènes, formulations impersonnelles ou passives, …) que tu as à disposition ou choisir une seule option et garder une sorte de cohérence tout au long de tes écrits?
Je choisis l’option inclusive en fonction de différents critères, parmi lesquels le public de destination, le type de texte (singularité poétique de l’écriture, volonté d’oralité fluide, etc.). En tant qu’éditrice, cela se fait toujours en conversation avec les auteurices. Pour un texte théorique ou critique à l’écriture simple, nous privilégions les points médians et ajoutons le X du neutre. En tant qu’autrice, j’essaie le plus souvent d’éviter les formes genrées, de trouver des termes épicènes ou des tournures de phrases sans accords. Lorsqu’il s’agit de mon écriture, j’aime les mots-valises sans points médians, ni tirets: éditeurices, auteurices, etc. Selon moi, rendre l’écriture la plus fluide possible est également une attention essentielle à l’inclusivité, notamment en termes de classe et de migration. C’est pour cette raison que je privilégie les solutions inventives aux règles académiques.
Le langage inclusif est-il, selon toi, seulement militant? Et si oui, penses-tu qu’il pourra devenir la norme dans les années à venir?
Chaque communauté se construit notamment par le langage, c’est une composante essentielle qui permet aux personnes de définir qui fait partie du groupe et qui en est exclu. Cela s’observe dans tous les types de communautés et c’est, je pense, encore le cas pour le langage inclusif aujourd’hui. Son usage courant se cantonne à certains milieux, et la mobilité langagière reste un privilège. J’aimerais que le langage inclusif devienne une norme, mais savoir si ce sera le cas dépend principalement de volontés politiques (et donc capitalistes) qui n’ont pas grand-chose à voir avec le fait que cela soit souhaitable ou juste.
Y a-t-il, selon toi, un phénomène de langage inclusif-washing?
Certainement, aux côtés du pink-washing, green-washing, etc. Cela rejoint mon commentaire précédent. Le langage de nos sociétés occidentales contemporaines est fondamentalement capitaliste. Le capitalisme étant structurellement construit de manière à se transformer pour se perpétuer, il fera du langage inclusif sa prochaine bataille si cela peut le servir. La tokenisation des luttes est un phénomène qui permet d’intégrer les luttes marginales sans pour autant opérer de transformation effective et fondamentale quant aux problèmes systémiques qui rendaient nécessaires les luttes initiales. Aujourd’hui, la réalité du langage inclusif en termes de genre est brouillonne et foisonnante: coexistence de règles multiples, confrontation de codes représentant les mille nuances subtiles des questions de genre, etc. Cette réalité en perpétuelle évolution et accompagnée d’une réflexion sincère sur ces questions me parait plus souhaitable qu’une application homogène mais simplement administrative ou conventionnelle du «é-e-x». Le capitalisme néo-libéral réfléchit par formule, c’est encore plus flagrant dans nos nouvelles réalités algorithmiques, je pense qu’une marge d’irrationalité et d’inventivité nous permettra d’être moins directement récupérables. Je désire un langage inclusif qui soit plein d’erreurs, celui des artistes et des travailleureuses, pas celui du marketing et des multinationales.
Utilises-tu un langage non-binaire? Et est-ce que tu trouves que les options de langage non-binaire en français sont adaptées et à l’écoute de la non-binarité?
Comme pour l’écriture, mon langage s’adapte au milieu dans lequel je suis. Si je porte toujours une attention particulière à la représentation de l’inclusivité dans ma parole, je ne le fais pas toujours de la même manière. Je travaille à la HEAD [ndlr, Haute école d’art et de design] et évolue dans les milieux de l’art contemporain. Dans ces espaces, l’utilisation du X final, même à l’oral, est totalement banalisée. Ce n’est pas forcément le cas dans d’autres milieux que je fréquente où je préfère utiliser d’autres stratégies de manière à pouvoir réellement communiquer avec et autour de ces questions.
Quels sont tes projets présents?
Liés à ces questions… Une publication avec Gorge Bataille, autrice et poétesse française, qui parle de sexualité, transgresse la distinction des sexes et questionne les normes et les rôles. Le projet de traduction collective Translating the impossible avec Lore Desalys, qui évolue autour de plusieurs événements et tente de faire de la traduction un espace social. FestaRita, une exposition et festival cet été avec plusieurs artistes et notamment Como Contemporanea, qui propose un atelier pour inventer des histoires. Leur installation visera à générer un acte performatif d’imagination collective; une rédaction ludique pour définir le destin de quatre personnages magiques, qui ont perdu tout espoir dans la censure. Iels nous invitent à suivre les règles pour mieux les briser. Ou alors Juri Bizotto et Natura Violenta qui proposent un atelier explorant les pratiques queer de survie (plutôt qu’artistiques) développées dans et en relation avec le contexte rural.
Propos recueillis par Clélia Colin